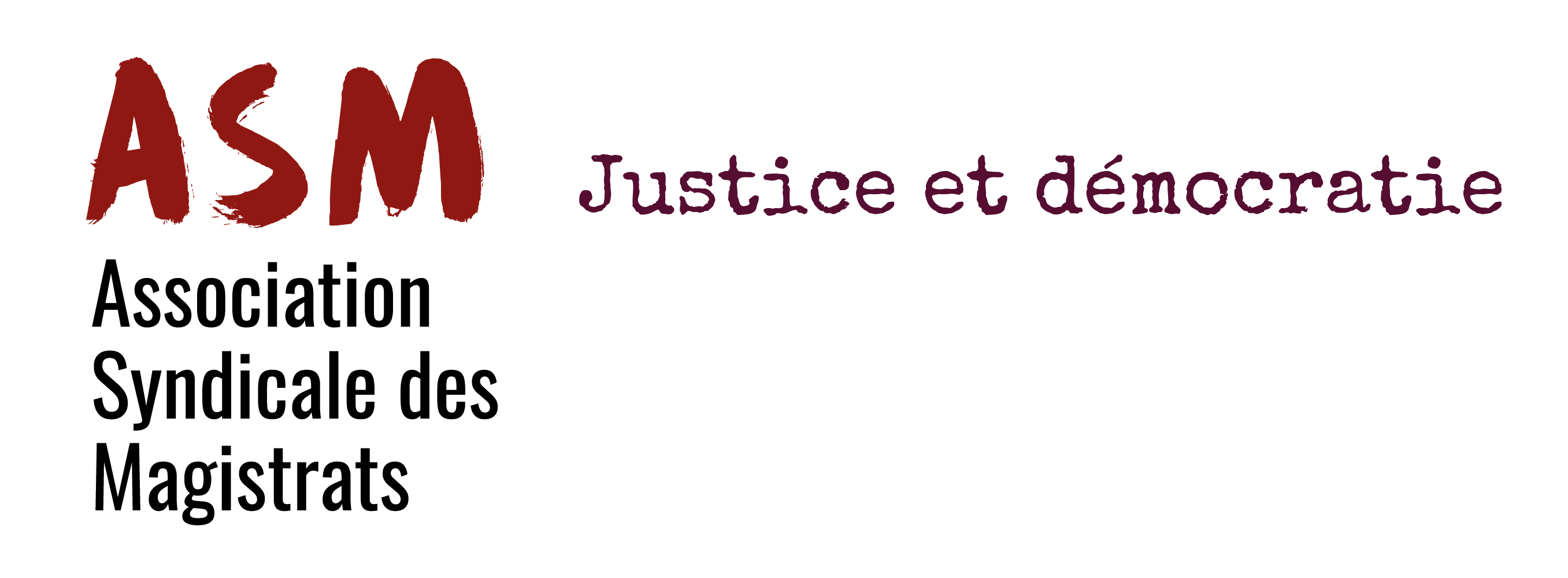Déclaration commune sur les réfugiés en Grèce.

Les signataires ont pris connaissance de la récente décision du gouvernement grec d’augmenter les mesures de dissuasion aux frontières au niveau maximal, de ne plus enregistrer de demandes d’asile pendant un mois et de renvoyer vers leur pays d’origine ou de transit toute personne tentant d’entrer en Grèce de façon irrégulière, suite à l’annonce des autorités turques de ne plus retenir les réfugiés à leurs frontières. Le premier ministre grec soutient que ces mesures sont prises en application de l’article 78.3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne – qui n’autorise pourtant pas de prise de décision unilatérale. Ces déclarations prennent place dans un contexte de violations massives des droits humains dénoncées de toute part dans le traitement des demandeurs d’asile qui sont retenus dans des hotspots surpeuplés dans les îles de la Mer Egée, qu’il s’agisse de l’accès à leurs besoins de base (logement décent, eau chaude, électricité, nourriture, chauffage, hygiène, santé…) ou de l’accès au droit (accès à un avocat, à une procédure équitable, à des recours effectifs contre les mesures de détention ou d’éloignement…), et des dysfonctionnements du système d’asile grec.
Le traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile en Turquie a également fait l’objet de condamnation par de nombreuses organisations internationales de défense des droits humains, malgré les efforts des autorités turques pour accueillir des milliers de réfugiés depuis le début du conflit en Syrie en 2011 et mettre en place un nouveau système d’asile. Ces organisations ont dénoncé en particulier le refoulement d’un grand nombre des réfugiés vers le nord de la Syrie, une zone qui a été décrite comme un « cauchemar humanitaire », où les populations civiles sont exposées à un risque imminent et grave de violation de leurs droits. Les signataires condamnent fermement toute atteinte aux droits fondamentaux des personnes cherchant asile dans l’Union Européenne. En aucun cas, la protection des frontières extérieures de l’Union Européenne ne permet à ses Etats membres de s’exonérer de leurs obligations découlant du droit européen, y compris de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la Convention européenne des droits de l’homme ou de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, qui prohibent les atteintes au droit à la vie, la soumission des individus à des traitements inhumains ou dégradants et le refoulement des demandeurs d’asile et qui garantissent le droit à l’asile et à la protection internationale pour toute personne en mouvement. Ni la suspension de l’enregistrement des demandes d’asile, ni les pratiques de pushbacks, ni les renvois expéditifs vers les pays d’origine ou de transit des demandeurs d’asile, ni le confinement dans des camps surpeuplés sans accès aux besoins de base et sans accès à des recours effectifs ne sont compatibles avec le droit international et européen des droits de l’Homme.
Les signataires tiennent à rappeler que l’Union Européenne « se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et de principe de l’Etat de droit », ainsi que l’énoncent le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’Article 2 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. Les signataires invitent
- les institutions européennes et les Etats membres, dans le cadre de l’application de l’article 78.3 du Traité, à prendre des mesures urgentes de répartition des demandeurs de protection internationale – tant ceux qui arrivent que ceux qui séjournent déjà dans des camps surpeuplés – , dans le respect des principes de responsabilité, de solidarité et de dignité, afin de garantir un accueil adéquat et l’accès au droit d’asile pour tous ceux qui atteignent le territoire européen ;
- les institutions européennes et les Etats membres à garantir à tous ceux et à toutes celles qui atteignent le territoire européen l’accès immédiat au droit d’asile, et à s’abstenir d’adopter et/ou à condamner et sanctionner toute loi ou mesure visant à suspendre l’application de ce droit, et à refouler les demandeurs d’asile vers des pays où ils risquent d’être exposés à des violations des droits humains, en violation flagrante du droit international et européen, y compris dans le cadre de l’application de l’article 78.3 TFUE ;
- les institutions européennes et les Etats membres à faire application de la directive 2001/55/CE spécifiquement prévue en cas d’afflux massif de personnes déplacées, afin que ceux-ci puissent bénéficier d’une protection temporaire ;
- les autorités grecques et turques à cesser toute mesure mettant en péril la vie et la dignité humaine ou visant à user de la force contre des personnes déplacées, en violation du droit international et européen, et les institutions et agences européennes à condamner et sanctionner ces pratiques plutôt que les soutenir ;
- l’Union Européenne et ses Etats membres à réviser leur politique migratoire visant à externaliser la responsabilité de la gestion de la migration à d’autres pays qui n’offrent pas des garanties suffisantes de respect des droits humains ;
- toutes les parties impliquées à respecter les droits humains et l’Etat de droit, tels que garantis par les Traités et le droit international et européen des droits humains et des réfugiés.
Liste des signataires
UIA -IROL (Institut pour l’Etat de droit – Union Internationale des Avocats), la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH), l’Association Européenne des Juristes pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (EJDH), les Avocats Européens Démocrates (AED), la Ligue Hellénique des Droits Humains, Human Rights Association (Turkey)/Insan Haklari Dernegi (IHD), la Ligue des Droits Humains (Belgique francophone), l’Association Syndicale des Magistrats (Belgique), Avocats Sans Frontières (Belgique), le Barreau de Cassation de Belgique, l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique (AVOCATS.BE), les Barreaux de Bruxelles francophone, du Brabant Wallon, de Charleroi, d’Eupen, de Huy, Liège, Mons, Tournai et Verviers (Belgique) et le Barreau de Luxembourg .